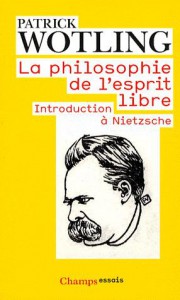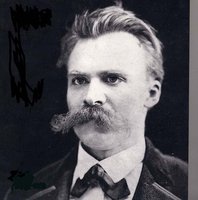Fichier PDF : Preface Patrick Wotling
Préface à La philosophie de l’esprit libre par Patrick Wotling
(Préface de l’ouvrage de Patrick Wotling, La philosophie de l’esprit libre – Introduction à Nietzsche, Champs essais 2008. Cet ouvrage à l’immense mérite de présenter de façon relativement claire les positions qui sont celle de Nietzsche, et je ne peux qu’en encourager la lecture à ceux et celles qui souhaitent, et plus encore ressentent la nécessité, d’en aborder le sens en cette époque trouble. La portée subversive des notions et des processus de pensée de Friedrich Nietzsche apparaît ainsi plus clairement.
Patrick Wotling est professeur à l’université de Reims. Il a traduit de nombreuses œuvres de Nietzsche dans la collection GF-Flammarion. Il est également l’auteur de Nietzsche et le problème de la civilisation (PUF, 1995 et 1999) et de La pensée du sous-sol (Allia, 1999).)
Stendhal se moquait volontiers de ces philosophes qui prétendent tout démontrer par la raison et demandent pour finir d’admettre ce que la raison de démontre pas, jugeant leur philosophie assez bien résumée par ce principe : « il me plaît de croire…1 ». Un penseur qui, comme Nietzsche, conteste l’autorité de la raison eût-il été à ses yeux en meilleur posture ? L’abandon de la confiance dans les pouvoirs de la démonstration objective placerait certes un tel personnage à l’abri du reproche d’hypocrisie, mais non pas d’arbitraire. Y aurait-il là une lacune de toute philosophie, propre à alimenter la perplexité ? Toute philosophie ne finirait-elle pas par se trouver à un certain point chassée de l’emprise de la preuve, et contrainte de gagner, pour parler avec Descartes, « le pays des romans2 ». Et pour en revenir au cas Nietzsche, d’où viennent donc les notions de volonté de puissance, de surhumain, d’éternel retour, de nihilisme ou de généalogie, que l’on présente couramment comme ses concepts fondamentaux, et auxquelles on prête la vertu de rendre limpide et de justifier des doctrines souvent difficile à pénétrer ? Ne serait-elle pas, elle aussi, de ces choses que l’on nous demande en fin de compte de croire ?
Il semble vain, dans cette perspective, de prétendre écarter le problème en rétorquant avec quelque scepticisme : mais Nietzsche est-il bien un philosophe ? Pour objecter implicitement : la question est-elle donc bien pertinente dans son cas ? Il est en effet fort conscient de la difficulté puisque l’on trouve chez lui, paradoxalement peut-être, un strict équivalent du reproche stendhalien auquel il semble bien prêter le flanc lui aussi. Analysant la pratique concrète des philosophes en la confrontant à leur programme théorique, il se trouve conduit à une conclusion sans appel : « Ils se présentent tous sans exception comme des gens qui auraient découvert et atteint leurs opinions propres en vertu du déploiement autonome d’une dialectique froide, pure, d’un détachement divin (à la différence des mystiques de tout rang, qui sont plus honnêtes qu’eux et plus lourdauds – ceux-ci parlent d’ « inspiration ») : alors qu’ils défendent au fond, avec des raisons cherchées après coup, un principe posée d’avance, un caprice, une « illumination », la plupart du temps un vœu de leur cœur rendu abstrait et passé au tamis : – ce sont, tous autant qu’ils sont, des avocats qui récusent cette dénomination, et même, pour la plupart, des porte-paroles retors de leurs préjugés, qu’ils baptisent « vérité »3. » Est-ce alors à dire que Nietzsche, pleinement conscient quant à lui des limites qui rendent vain tout effort de justification objective intégrale, ferait le choix, cynique, à tout le moins désabusé, de la gratuité, bref qu’il s’accorderait la facilité de s’aligner en quelque sorte sur la position des mystiques ? Si brillant qu’ils soient, « Monsieur Nietzsche » ne prétendait-il que nous livrer ses préjugés ? Et dans ce cas leur incontestable originalité suffirait-elle à racheter leur douteuse provenance ? Qu’importerait au lecteur animé par le désir de comprendre, dans ces conditions, l’idée de volonté de puissance, la pensée du surhumain, ou la doctrine de l’éternel retour ? Si nulle nécessité ne porte et n’impose ces dernières, on ne saurait lui reprocher de pencher pour le jugement de Lucien Leuwen : « Tout cela est vrai, ou tout cela est faux », et sa logique conclusion : « peu m’importe ».
L’ambition de ce volume est de dissiper le sentiment sourd d’arbitraire qui peut accompagner, sans doute assez communément, la rencontre de Nietzsche, plus communément sans doute que ce n’est le cas des philosophes qui le précèdent. Son objectif est d’offrir au lecteur une voie d’accès à la démarche que suit le philosophe, de lui en montrer la logique, de lui indiquer quelques-unes des principales justifications sur lesquelles Nietzsche s’appuie constamment, et de faire apparaître les raisons qui légitiment les positions qu’il adopte. Nietzsche n’a de fait rien d’un mystique, d’un romantique, ou d’un irrationaliste, si l’on entend par là un esprit qui se dispenserait de toute cohérence pour adorer la seule affirmation – il a, en revanche, bel et bien tout fait pour compliquer la tâche de son lecteur. Et ce, avant tout en masquant la cohérence à laquelle il se soumet.
Cet ouvrage, pour cette raison, ne se présentera pas comme une monographie classique. Il ne se fixe pas pour tâche d’évoquer la totalité des sujets abordés par Nietzsche – tâche difficilement réalisable dans son cas, qui conduirait inévitablement à demeurer allusif. Tout au contraire, il privilégie quelques questions centrales qui rayonnent dans toute l’oeuvre pour les étudier en détail, en s’imposant de rendre accessible le parcours qui les analyse, et souvent les transforme.
Comprendre un philosophe implique généralement de partir des problèmes qu’il pose, et non des notions qu’il construit. Ceci est suprêmement vérifiable dans le cas de la pensée de Nietzsche. Il est indispensable d’indiquer tout d’abord comment se constituent les problèmes que Nietzsche reconnaît pour pertinents – et pourquoi certains types de questions sont en revanche écartés, ou réorganisés. C’est pourquoi toutes les études présentées dans ce volume ont en commun d’expliquer et de justifier l’évolution que ce penseur novateur impose à quelques concepts fondamentaux de la réflexion philosophique. Dans sa visée finale, par conséquent, ce livre a bien pour objectif d’expliquer le sens de quelques-unes des notions les plus importantes, et souvent les plus intrigantes, qui organisent l’ensemble de la pensée de Nietzsche, et pour cela, d’aider à comprendre pourquoi et comment se sont imposés à son enquête certains problèmes fondamentaux auxquels ces notions apportent une tentative de résolution. Toute la difficulté de la pensée de Nietzsche tient avant tout, comme nous l’avons suggéré, à la rénovation considérable que subissent avec lui les interrogations classiques de la philosophie. La première chose à comprendre pour entrer dans cet univers de pensée est en effet celle-ci : ce sont plus les problèmes définis par la philosophie que ses solutions qui suscitent le soupçon. Examinée attentivement, la forme de certaines questions sur lesquelles ne cessent de revenir les philosophes mérite de susciter la perplexité. C’est pourquoi il est fréquent, presque systématique en réalité, que Nietzsche reformule les problèmes qu’ont élaborés bien avant lui les grands courants de la pensée philosophique. Il est indispensable de décrire, par conséquent, la forme nouvelle que prennent ces questions anciennes, et ce faisant de fournir les informations essentielles qui ouvrent l’accès à la réflexion de Nietzsche dans son ensemble. En d’autres termes, il nous paraît donc capital d’expliquer comment les problèmes qu’affrontent Nietzsche en sont venus à se constituer. Et pour lui, ils se révèlent d’abord à la faveur de l’examen des assurances sur lesquelles se sont appuyés les philosophes durant des siècles. Des assurances si fermes qu’elles parviennent à se soustraire à l’examen. C’est cette capacité à déceler les difficultés habitant nos certitudes, et cependant masquées par le sentiment d’accoutumance, qui fait l’esprit libre : « On appelle esprit libre celui qui pense autrement qu’on ne s’y attend de sa part en raison de son origine, de son milieu, de son état et de sa fonction, ou en raison des opinions régnantes de son temps4. » La philosophie aussi a créé des habitudes, et laissé s’assoupir son esprit de méfiance.
Ajoutons pour esquisser plus complètement le parcours que nous propose l’enquête nietzschéenne – la philosophie qui s’impose à un esprit vraiment libre – qu’il ne suffira jamais de repérer, de dénoncer et de combattre les préjugés : il faudra encore en saisir les origines et surtout comprendre comment ils ont pu en venir à régner. Il faut donc y insister : la première tâche qui s’impose est de saisir comment ces problèmes, souvent neufs, se dégagent et finissent par s’imposer à partir de l’expertise des problèmes classique que définissaient et traitaient les philosophes depuis Platon. C’est la découverte de déficiences graves affectant la justification de ces problèmes qui justifie à son tour leur évolution. Avec une régularité qui devient progressivement inquiétante, l’analyse du travail mené par les philosophes met en évidence des lacunes dont la récurrence systématique contraint à envisager l’hypothèse qu’elles traduisent des positions de principe, peut-être inconscientes, mais à coup sûr remarquablement organisées. Non pas des erreurs, mais bien des préjugés donc, dont le réseau structure l’espace laissé ouvert au questionnement, et dont le maintien remarquablement stable sur deux millénaires pourrait bien constituer alors la marque distinctive de ce qui a été compris – et admis – jusqu’à présent sous le nom de « philosophie ». Libérer l’idée même de philosophie, l’idéal d’une interrogation radicale et scrupuleuse, de la pratique réductrice des penseurs qui faisaient pourtant profession de la défendre, telle est l’ambition qui guide en premier lieu la réflexion de Nietzsche. Ce n’est pas donc le souci de l’originalité qui oriente Nietzsche, mais bien le souci de la probité. Or les philosophes, dans cette perspective, sont loin d’être irréprochables. Ils ne justifient pas, en effet, la totalité de leurs positions. Il est donc essentiel, pour entrer dans la réflexion de Nietzsche, de ne pas se contenter de souligner l’aspect critique et destructeur de son intervention. Cette dernière – c’est du reste un leitmotiv constant de ses textes – ne constitue nullement le but poursuivi par le philosophe. Ajoutons que le renouvellement considérable des études nietzschéennes depuis une vingtaine d’années, les avancées de la recherche qui en sont issues, permettent désormais de mieux comprendre quelles sont les ambitions propres à la pensée nietzschéenne, ainsi que de cerner plus précisément les procédures en fonction desquelles elle s’organise.
La vérité, devenue objet de soupçon, le rejet de la métaphysique, le refus de l’organisation systématique, la mise en cause de la volonté, et, inversement, le corps, dont Nietzsche révèle le rôle déterminant, la pulsion et la volonté de puissance, la pensée de l’éternel retour, la tâche du philosophe : telles ont quelques-unes des notions centrales sur lesquelles repose cette manière nouvelle de faire de la philosophie. Les études qui suivent se proposent d’en justifier la promotion et d’en exposer les implications pour la conduite de la réflexion. Leur exigence commune est de défendre les droits de la probité en manière de pensée.
Car c’est sur le plan de l’éthique que se place ce penseur à l’immoralisme revendiqué pour mettre en relief les déficiences communes de la pratique philosophique – une éthique, certes, repensée de manière profonde. Pourquoi certaines questions demeurent-elles comme interdites à cette activité qui fait pourtant de la radicalité de l’interrogation le fondement de sa supériorité sur les savoirs particuliers, qu’elle accuse de ne pouvoir se justifier de façon autonome et intégrale ? Telle est la question qu’aborde l’étude intitulée « Les questions que les philosophes ne posent pas ». S’il est un domaine où la rectitude intellectuelle est exigible, c’est bien celui-ci en effet. Or, en analysant les mécanismes d’interrogation que met en œuvre la philosophie, Nietzsche remarque que l’effort de légitimation assumé par les philosophes rencontre systématiquement des bornes. L’interruption de l’enquête à un stade donné semble en effet, curieusement, faire partie du dispositif d’exploration, sans que survienne pour autant un quelconque sentiment d’incomplétude. La conscience morale des philosophes serait-elle complice de leurs défaillances ?
C’est ce dont témoignera en effet la reprise des grandes problématiques des philosophes, et pour commencer celle de la vérité. Est-il après tout si évident que la recherche de la vérité s’impose comme un but inattaquable à la réflexion des philosophes ? Ayons le courage – les philosophes en ont peut-être manqué – d’affronter cette question : pourquoi voulons-nous la vérité ? Pourquoi la voulons-nous avec une passion aussi irrésistible, qui nous ordonne de tout sacrifier à sa conquête ? Pourquoi refusons-nous avec une telle horreur l’idée du faux et l’idée de la tromperie ? De cette enquête ressortira ce fait déterminant pour la suite du propos, que cette question inaugurale repose sur des choix inaperçus, inconscients mais exerçant une action régulatrice implacable sur notre pensée : en d’autres termes des valeurs. Comment prendre en compte, alors, la découverte du rôle inévitable de ces valeurs dans l’activité de pensée, et notamment dans la compréhension de la tâche du philosophe ? C’est là le problème qu’envisage la sixième étude de cet ouvrage, en présentant la manière selon laquelle l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra caractérise le statut du penseur.
On présente souvent Nietzsche comme l’adversaire par excellence de la métaphysique. Mais comment justifier ce qui peut sembler un parti pris, une hostilité de principe ? D’autant que la métaphysique est diverse, voire insituable dans sa globalité tant le spectre de ses expressions est riche. Peut-être est-ce là du reste la raison pour laquelle Nietzsche emploie en fait si peu le terme de « métaphysique », lui préférant souvent celui d’ « idéalisme ». La critique n’en est pas moins généralisée. Or ce qui s’avère la justifier, comme l’indique l’analyse de détail, c’est l’identification d’une manière bien particulière de raisonner et de conclure – un nouveau préjugé, et l’un des plus puissants qu’il nous soit donné de rencontrer : le préjuger atomiste, qui explique ce qu’est la métaphysique, et comment elle procède, quelle que soit l’étendue de ses variantes. L’élément constamment actif ici est bien en effet un besoin forcené de trouver de l’unité, sous une forme ou une autre, dans tout ce que nous jugeons « réel », y compris dans la pensée. L’identification de ces préjugés devra alors inciter le philosophe désormais éclairé à s’en garder.
Si l’on considère à présent l’aspect positif de sa construction, pourquoi Nietzsche se réfère-t-il si constamment à la notion de pulsion ou d’instinct pour mener à bien ses propres analyses, tant dans le domaine du savoir que dans celui de la pratique (morale, politique, religieuse), ou encore dans celui de la création artistique ? Ou plus exactement : en quoi cette notion change-t-elle quelque chose à la situation de déficience qu’il reproche si constamment à ses collègues philosophes ? Une lecture hâtive peut donner le sentiment que Nietzsche ne fait qu’introduire un principe nouveau, sans modifier en profondeur la méthodologie ordinaire du questionnement. Mais avec la notion de pulsion, si constamment invoquée par l’auteur de Par-delà bien et mal pour élucider les champs les plus divers de l’activité humaine, c’est bien une logique d’analyse nouvelle, et non un nouveau principe, qui se révèle. C’est ce qui permet de comprendre ces notations récurrentes, si énigmatiques, critiquant la notion dont Nietzsche use pourtant sans relâche, comme s’il prenait curieusement plaisir à réduire à néant ce qu’il privilégie pourtant…
L’objectif est ainsi de faire sentir au lecteur qu’il serait dénué de sens de poser à cette notion nouvelle les questions qui caractérisent les modes de pensée anciens : la pulsion serait-elle la forme d’être la plus fondamentale ? Comme une version nouvelle de l’ens realissimum métaphysique, à partir duquel il deviendrait possible de dériver la totalité de ce qui existe ? Mais il s’agit au contraire de bien comprendre que l’élucidation de la réalité à partir des notions de pulsion, d’instinct ou d’affect représente un changement radical de méthode d’analyse : il est nécessaire de perdre l’habitude, entachée de préjugés et donc philosophiquement irrecevable, de chercher à ramener l’ensemble du réel à une réalité unique, invariante et identique à soi. Le premier intérêt, l’intérêt essentiel, du recours à la notion de pulsion sera bien d’indiquer au lecteur qu’il n’est nullement nécessaire pour analyser efficacement la réalité, de la réduire à la manifestation d’une rationalité absolue, ou d’un être fondamental. La voie sera libre alors pour la mise au jour d’une logique de l’infraconscient, de la régulation organique dans laquelle la rivalité et la recherche de la maîtrise jouent un rôle prépondérant. Nietzsche introduira la notion de « volonté de puissance », et parallèlement celle d’ « interprétation », pour désigner synthétiquement cette logique. L’interprétation et non l’être – d’où aussi l’affirmation que la pulsion n’existe pas ; d’où, surtout, la mise en garde si révélatrice de l’esprit de la pensée nietzschéenne : il convient de veiller à ne pas faire de cette notion une simple facilité, un principe magique, une explication à tout faire…
Il existe un lien étroit entre la notion de pulsion et celle de corps. Toute réalité est corps – « je suis corps, et rien d’autre » affirme Zarathoustra -, c’est là une des thèses les mieux connues de Nietzsche. Mais sa compréhension est plus délicate qu’il n’y paraît. D’abord parce que Nietzsche ne soutient en rien une position classiquement matérialiste. Car si tout est corps, le corps n’est pas une entité matérielle. Qu’est-ce donc que le corps ? C’est bien à partir de la réflexion sur les pulsions que ce problème peut trouver une solution. Inaugurant un type de problématique que nous aurons fréquemment l’occasion de retrouver, notamment dans le cadre de l’étude de la volonté, Nietzsche montre alors que le corps désigne non pas un être mais un certain type de relation, ou plutôt de collaboration entre les pulsions. L’analyse du statut du corps et l’enquête sur le sens de l’idée de pulsion conduisent alors de nouveau à la notion de valeur, qu’il faudra se garder de traiter comme un nouveau fondement.
Peut-on, doit-on dire alors que le fond de toute réalité est corps ? Sans doute, mais sans que cette réponse ait le sens que lui donnerait un philosophe matérialiste. Nous venons de l’indiquer, le corps n’est rien d’autre que la logique qui régente le jeux des pulsions. Et à ce titre, il doit être décrit par renvoie à la notion d’esprit – un ensemble de petites âmes. Est-ce alors la pulsion ? Mais que faire de ces textes qui relativisent celle-ci et la donnent pour une fiction ? Serait-ce donc la valeur ? Nietzsche rétorquera que les valeurs ne sont jamais que le produit, fixé au terme d’un très long processus, d’habitudes de vie et de pensée que s’impose une communauté (ou qu’elle se voit imposé). Faire intervenir l’idée de volonté de puissance, tentation constante du commentarisme, ne réglerait pas davantage le problème puisque cette notion est renvoyé à celle de pulsion et nous ramène donc aux difficultés antérieures. Est-il seulement possible de détecter une instance autonome, qui seule permettrait de retrouver l’ordre de l’objectivité ? On assiste donc à un jeu constant de renvoi des notions les unes aux autres. Il est clair que Nietzsche veut par là effacer toute possibilité pour la pensée de se fixer sur un point de départ qui ne manquerait pas de jouer le rôle d’un absolu de substitution. Car seul est réel, en effet, le mode de relation qui se joue dans les différents champs auxquels Nietzsche se réfère, ce mode de relation qui structure le corps vivant, pousse les pulsions à la coalition ou à la rivalité. C’est ainsi au problème du type de relation organisant le réel que répond la pensée nietzschéenne du corps.
L’une des retombées les plus spectaculaires de la découverte de l’omniprésence des pulsions est constituée par la réévaluation de l’égoïsme. Cet aspect très frappant de l’immoralisme de Nietzsche a parfois été considéré comme le signe de l’arbitraire de son propos. Il découle en fait de la découverte de ce fait que tout individu n’est qu’une unité de composition, variable, changeante, ou plus exactement une unité d’organisation – et non l’unité d’une essence simple et immuable. Parallèlement, Nietzsche souligne avec brio les difficultés et contradictions auxquelles conduit, en matière morale, la défense de l’altruisme et la condamnation de l’égoïsme. En tout individu, c’est l’originalité d’une certaine organisation de pulsions qui se donne à voir, et il existe donc une forme nécessaire d’égoïsme, celle qui exprime les besoins propres à la forme de vie qu’incarne ce vivant. Entendue dans cette perspective, l’autobiographie – par exemple l’histoire intellectuelle de ce « je » complexe et multiple qui se raconte dans Ecce homo – devient un objet majeur de l’enquête philosophique.
Ce n’est du reste pas le seul motif moral qui donne lieu à une recomposition révélatrice chez Nietzsche. Si la promotion de la pulsion impose celle de la volonté de puissance, comment la logique de la puissance – constitutive de la réalité sous toutes ses facettes – se traduit-elle dans le champs des phénomènes moraux (ou dits tels) ? Toutes les anciennes « vertus » ne se trouvent-elles pas exclues par principe de cette logique ? C’est à l’un des aspects principaux de cette question que la notion de justice – que Nietzsche est loin de condamner – apporte une réponse. Car il est nécessaire de distinguer deux choses : l’affirmation de l’autonomie de la morale, qui va de pair avec le refus de dériver les phénomènes moraux de tout autre domaine ; et d’autre part, indépendamment de ce statut légitime ou non, la réalité de phénomènes qu’il s’agit pour le philosophe d’analyser, quel que soit le champs auquel ils se rattachent effectivement. Or si Nietzsche souligne fréquemment que tous les phénomènes habituellement considérés comme spécifiquement moraux ont en fait des origines extramorales, il ne nie pas nécessairement leur existence. Il souligne en revanche la nécessité, par probité intellectuelle, de les reconsidérer pour comprendre ce qui s’y produit effectivement. La justice n’est sans doute pas toujours aussi purement morale qu’on le pense, mais elle n’en existe pas moins. Elle s’analyse parfaitement à partir de la logique de collaboration et de rivalité qui animent les groupements pulsionnels : l’analyse nietzschéenne montrant qu’elle représente la réponse à une situation limite, celle où la rivalité oppose des groupements (pulsions, hommes, ou peuples) de puissance comparable.
Aux confins du moral et du psychologique, la notion de passion fait également l’objet d’un réexamen. Cette grande mal-aimée de la philosophie – sauvée il est vrai à l’époque moderne, en particulier par les penseurs britanniques, Hume ne tête – réserve elle-aussi des révélations. Repensée à travers le concept d’ « affect », qui souligne se dimension inconsciente, la sensibilité hâtivement condamnée sera reconnue pour une dimension primordiale de la pulsion. De la sorte, elle constituera un rouage décisif pour comprendre le fonctionnement de l’interprétation sur la base d’une série de valeurs. L’une des révolutions les plus radicales opérées par Nietzsche sera ainsi de montrer que l’affectivité constitue la base de toute pensée. Repensée comme affect, la passion apporte un éclairage complémentaire au sens des notions de pulsions et de corps.
Que signifie la doctrine de l’éternel retour ? Cette interrogation peut sembler quelque peu détachée des considérations précédentes. Et si elle est une des notions qui intriguent et fascinent le plus chez Nietzsche, elle est sans doute aussi l’une des plus décourageantes par la complexité – voire la nébulosité – du contexte intellectuel dans lequel elle prend place. Elle est pourtant liée aux interrogations et analyses que nous venons d’évoquer et que détaille le présent ouvrage. Prenant appui sur la brillante analyse tentée par l’une des figures éminentes des études nietzschéennes de l’après-guerre, Karl Löwith, l’étude que nous consacrons à cette pensée s’efforce précisément de l’établir en montrant qu’elle se présente moins comme une théorie (physique, cosmologique, ou autre), c’est-à-dire comme un savoir reflétant un état de fait objectif, que comme une voie indiquant la possibilité de valeurs nouvelles et appelant à les réaliser effectivement. Les analyses consacrées précédemment à la remise en cause de la vérité et au statut du philosophe avaient souligné la dimension pratique de sa tâche. C’est dans ce cadre que la doctrine de l’éternel retour révèle sa signification majeure.
L’étude consacrée à l’idée de volonté se présente d’abord comme analyse d’une séquence d’argumentation formant une unité, celle que constituent les paragraphes 16, 17 et 19 de la première section de Par-delà bien et mal, intitulée « Des préjugés des philosophes ». Cette analyse est centrée sur la paragraphe 19, qui critique l’assimilation de la volonté à une faculté, c’est-à-dire au pouvoir de causer des actions. L’intérêt que l’on doit prêter à cette séquence se justifie par le fait qu’elle prépare directement le texte, exceptionnellement important, qui avancera cette hypothèse que la réalité toute entière est compréhensible comme volonté de puissance. C’est le paragraphe 36 de Par-delà bien et mal qui exposera l’argumentation au moyen de laquelle Nietzsche soutient cette hypothèse. Cette étude présente ainsi tout d’abord un échantillon du mode d’organisation – de la méthodologie si l’on veut – qui caractérise la réflexion de Nietzsche, toujours présentée sous la forme scindée et difficile à suivre d’une succession d’aphorismes. Nous partons donc d’une critique de la volonté, mais il est clair que ce n’est qu’un point de départ, et que sur ce point, la réflexion nietzschéenne nous conduit bien au-delà du débat technique sur un point de psychologie ou de métaphysique. Ce n’est pas uniquement le statut exact de la volonté qui intéresse Nietzsche, mais bien plus ce que révèle notre vision ordinaire de la volonté ; car ce que met en jeu cette question, c’est la nature de la réalité elle-même. La compréhension que critique Nietzsche, celle qui fait de la volonté une faculté, un pouvoir de déclencher des actions – ou aussi bien de suspendre pour un temps ce déclenchement – qu’aurait à sa disposition le sujet, prend en effet une option sur la compréhension du réel. Elle suppose notamment qu’il existe d’un côté des êtres, choses ou substrats, et de l’autre des actes, imputables à un pouvoir détenu par certains de ces êtres, l’homme au premier chef. C’est sans doute là notre foi la plus invincible, notre préjugé le plus ferme : nous nous considérons spontanément comme des êtres qui agissent, et l’expérience, qui semble le confirmer continuellement, ne fait que nous conforter dans cette croyance. Nous subordonnons toute action à la libre intervention d’un sujet. Mais la remise en cause de cette foi produira un effet en retour sur notre compréhension implicite de la réalité en nous contraignant à voir que celle-ci ne comporte que de l’agir, que des actions ou des événements – et qu’elle est structurée par le type de communication qui est propre à ces pulsions.
Les brèves remarques qui précèdent auront indiqué à quel point il est fréquent, du fait de la réorganisation que Nietzsche impose aux problèmes de la philosophie, que la restitution de ces analyses exige des précautions, des mises en garde et des nuances. Si Nietzsche est un penseur original, il est à coup sûr aussi un penseur dont l’originalité tient pour une part à ce qu’il n’écrit pas comme les autres philosophes. Et à cela, il y a de tout autres raisons que la volonté de se montrer original. S’il n’y a pas de choses, mais uniquement des actes et des événements, fluents, impossibles à fixer, comment doit-on faire usage du langage et des mots, qui ne cessent de suggérer la fixité et l’unité ? Si la démonstration s’avère intrinsèquement suspecte, comment le philosophe, qui refuse la simple opinion, peut-il encore communiquer ? Tel est le problème qu’aborde l’ultime étude proposée dans ce recueil en se penchant sur la question de l’écriture du philosophe – problème qui constitue un préalable à l’accès effectif aux textes de Nietzsche, et problème sur lequel il a si souvent choisi de clore les livres qu’il offrait à la sagacité du lecteur.
Que ressort-il de ces parcours ? Avant tout que le souci directeur de Nietzsche est de rejeter toute idée de fondement, de même que la démarche qui assimile, classiquement, la preuve à la dérivation à partir d’un fondement. Que tout volonté de détecter un absolu met la pensée en contradiction avec elle-même. Et plus profondément, que la réflexion philosophique doit, pour s’exercer dans toute sa puissance d’investigation, s’adosser à une logique plus rigoureuse et plus critique que celle qui fut pratiquée jusqu’alors – telle est l’exigence qui caractérise véritablement le penseur à l’esprit libre. Fort de ces réflexes, le philosophe ne manquera pas de se demander : quelle est pour Nietzsche la réalité dernière, entendons celle à partir de laquelle il deviendra possible de rendre raison de tout ce qui est ? Cette question n’admet pas de réponse chez Nietzsche. Plus profondément, elle ne fait pas sens, révélant out au plus, à titre de symptôme, la persistance d’une manière de déterminer les questions qui n’est immédiatement ressentie comme légitime que parce qu’elle s’appuie sur une habitude de penser bimillénaire, au prestige invincible, propre de ce fait à satisfaire un besoin devenu pour nous une seconde nature, et pour cela à masquer efficacement les incertitudes et faiblesses de cette manière de penser. Ce n’est pas éviter la question qu’indiquer en quoi elle doit être rectifiée. Et si l’on accorde ces nuances, Nietzsche apporte bien une réponse : la réalité est pensable comme interprétation – elle est l’ensemble des interactions entre les pulsions, qui travaillent sans cesse, à la faveur de regroupements et d’alliances constituant des organismes, à se contrôler mutuellement. Deux nuances infléchissent cependant la formulation trop affirmatrice que nous venons de privilégier : cette lecture de la réalité n’est présentée par Nietzsche que sous forme d’une hypothèse – même si, il et vrai, son argumentation indique que nous sommes nécessairement conduits à formuler cette hypothèse, qui n’a rien de gratuit ni de fortuit. Et surtout, la pulsion, ou la volonté de puissance, n’est pas une chose – elle est présentée comme un processus mettant en œuvre l’activité d’interprétation. Ce qui revient à dire non seulement que la pulsion n’est pas un être et que la problématique ontologique n’est pas pertinente, mais bien plus, et ceci est moins aisée à voir, qu’elle ne possède pas d’objectivité, étant une interprétation. La lecture que nous pouvons faire du réel, si rigoureuse qu’elle soit, si exercée à écarter les préjugés et les faiblesses logiques qui ont longtemps menacé la philosophie, n’en demeure pas moins une interprétation – qui affirme fort logiquement que toute réalité est interprétative ; cette interprétation peut bien être nécessaire, pour des vivants constitués comme nous le sommes, elle peut bien être élaborée avec le plus grand scrupule et la plus grande rigueur critique – et ceci est exigible du philosophe -, l’idée de vérité ne lui est plus applicable. C’est à une conclusion vertigineuse que nous conduit la réflexion de Nietzsche. Si la réalité est le jeu infini des pulsions, le philosophe n’est pas extérieur à ce jeu ; la philosophie exige qu’il le joue avec probité. Comprendre cette logique, et plus encore l’accepter, tel est ce qui fait l’esprit libre.
Patrick Wotling.
1Ce sont plus précisément les « profondeurs de la philosophie allemande » que vise la remarque ironique placée par Stendhal dans la bouche de Lucien Leuwen : « lorsqu’elle est à bout de raisonnements, elle explique fort bien, par un appel à la foi, ce dont elle ne peut rendre compte par la simple raison » (Lucien Leuwen, première partie, chap. VIII, in Romans et nouvelles, tome I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 852).
2Lettre à Mersenne du 20 novembre 1629.
3Par-delà bien et mal, § 5, GF-Flammarion, p. 51.